Where is Brian ?
- Dominique

- 9 juil. 2022
- 4 min de lecture
Aujourd'hui, je vais utiliser une forme d'expression à la mode dans mon journal préféré Le Monde : le «live». Le Monde fait des «lives» sur tout: la guerre en Ukraine, les sujets du bac français, l'actualité politique française, le Tour de France… En quoi consiste un «live» ? Des spécialistes d'une question ou des journalistes répondent en direct, par écrit, aux questions des lecteurs, proposent des liens vers des articles de fond du Monde, donnent des infos en continu à la façon de BFM. Ces «lives» ont débuté avec la guerre en Ukraine et devant le succès de la formule, les «lives» se sont multipliés (il y en 4 en cours aujourd'hui). En perte de vitesse, la presse écrite est obligée de se renouveler, concurrencée par l'audiovisuel et surtout les réseaux sociaux. N'étant spécialiste de rien, je vais quand même répondre en direct à une question que l'on m'a posée souvent depuis notre départ : «vos amis ne vous manquent-ils pas ?» et «where is Brian ?».
A priori, aucun lien entre les deux questions et pourtant…
Très sociable, rompue aux échanges avec mes élèves, collègues et amis, se retrouver dans un camping car avec un unique compagnon n'a - a priori- rien d'évident. Aimant avant tout lire, écrire, apprendre, choses auxquelles je peux consacrer tout le temps qui me convient, mon ancienne vie ne me manque pas. Parfois, mes amis me manquent mais, si on y réfléchit bien, nous sommes tellement occupés par nos vies professionnelles intenses que nous ne consacrons que peu de temps aux autres. Mes filles me manquent, mais elles ont aussi une vie et celles-ci ne coïncident plus beaucoup, à mon grand regret. Ce qui me manque parfois, c'est plutôt une prise sur le réel. La formulation est maladroite mais découvrir un pays, ce n'est pas, pour moi en tout cas, juste le parcourir, admirer ses lieux les plus emblématiques ou ses paysages les plus sublimes. C'est plutôt saisir l'«âme» du pays, formule tout aussi vague, c'est à dire se frotter à sa vie quotidienne, ses conflits, ses particularités culturelles. Et pour saisir cette «âme», il faut communiquer. Et là, j'arrive à cette question existentielle «where is Brian ?»
Après plus de trois mois passés en Irlande, les trois prochains mois en Ecosse et en prévision d' un futur très grand voyage en Amérique du Nord, je me suis - enfin - résignée à travailler mon anglais.

Résignée est le mot qui convient. J'ai toujours détesté apprendre une autre langue que la mienne. Un Néerlandais rencontré en Égypte et interprète auprès des institutions européennes, m'a dit que les Français étaient tellement persuadés de la beauté de leur langue, sous entendu la supériorité de celle ci, qu'ils ne voyaient pas pourquoi en apprendre une autre, que c'était aux autres peuples d'apprendre la leur. C'est probablement vrai dans mon cas, mais il n'y a pas que cet aspect. Issue d'un milieu peu cultivé, j'avais d'abord besoin de maîtriser ma propre langue pour réussir dans mes études. Donc, comme tout le monde, j'ai appris l'anglais en classe de sixième avec l'incroyable question : «where is Brian ?» qui a traumatisé des milliers d'élèves car il n'était absolument pas évident de trouver Brian dans la «kitchen».
Comme Gad Elmaleh, je n'ai pas réussi à placer cette célèbre question, puis réponse, dans une conversation. Mon principal problème est la compréhension orale donc j'ai décidé de travailler mon anglais en regardant des séries, en anglais bien sûr, sur Netflix.

J'ai choisi «13 reasons why» qui raconte l'histoire d'une lycéenne qui se fait harceler, violer et finit par se suicider. Mais quelle idée ! Comment vais-je replacer dans une conversation : «suicide», «death», «trial» ? Les Irlandais vont penser que les Français sont dépressifs et suicidaires ? C'est également en regardant ma série que je me suis rendue compte que mon anglais était très châtié, très scolaire.
En terminale, j'ai étudié la chanson «The sound of silence» de Simon et Garfunkel : «Hello darkness my old friend». Quoi, encore un truc de dépressif ? C'est quoi le message ? «The sound of silence ?» Il vaut mieux se taire que parler anglais ? En tout cas en regardant ma série, je me suis rendue compte que je ne connaissais aucun gros mot. J'ai vraiment acquis du vocabulaire depuis, grâce à ma série : «dick» (bite), «asshole» (trou du cul)… Je progresse en anglais, je suis ravie ! Quasiment toutes les phrases dans ma série commencent par «fuck» et se terminent par «asshole». Trop facile l'anglais ! Un petit «fuck», tu mets un ou deux mots, tu finis par «asshole» et le tour est joué. Je me vois bien fièrement utiliser mon nouveau vocabulaire auprès d'un charmant serveur dans un pub : «fuck, a Guiness please, asshole». Vais-je obtenir le résultat attendu, une Guiness ? Après, ce n'est pas bien grave, vu que je déteste la bière et la Guiness tout particulièrement.
Pas encore prête pour «fuck» et «asshole», je me suis dite : reprenons les basiques, quoi de plus consensuel qu'une petite conversation sur le temps, en Irlande ? Je mets en place le cadre: moi chevauchant Roberta, mon blanc destrier électrique; un temps de fin du monde, soit une pluie battante et un vent à décorner les bœufs; un homme sortant de son 4x4. Il me regarde galérer sous la pluie, trempée et frigorifiée. Je lui fais un grand sourire et lui dit avec mon meilleur anglais «nice weather». Il a beaucoup ri.
Pour ma prochaine tentative de conversation en anglais, je vais essayer de placer trois mots : «My taylor is rich», soit une autre première phrase mythique de la méthode Assimil «l'anglais sans peine», datant de 1929. Les Français ont-ils progressé en anglais entre le «taylor» des années 1930 et «Brian is in the Kitchen» des années 1970-1980?
J'ai comme un vague doute.

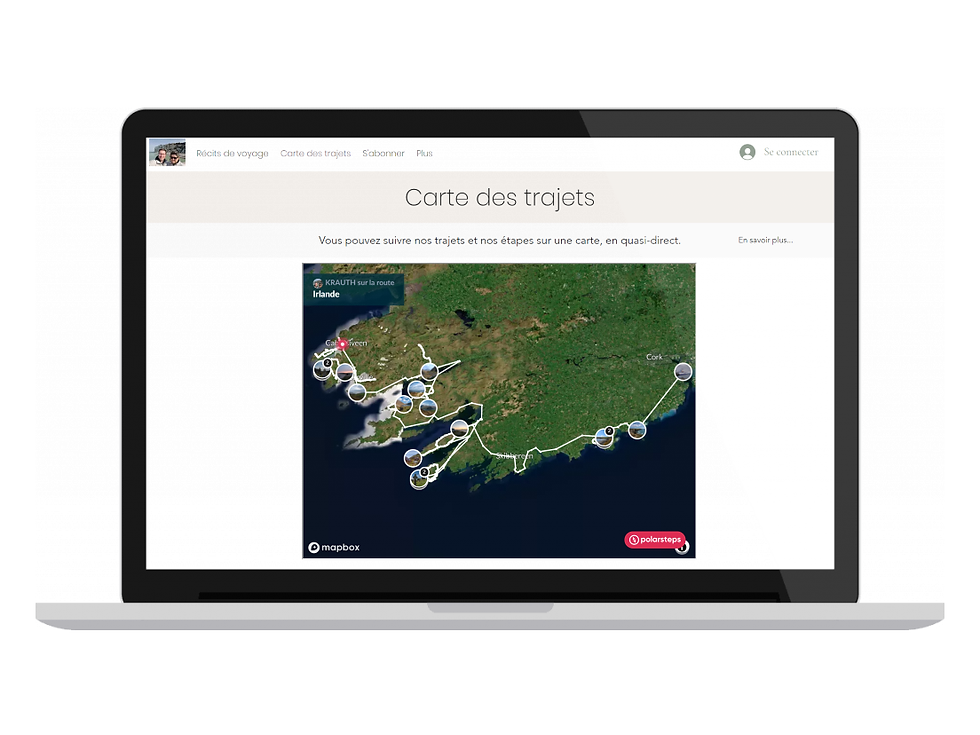
Commentaires